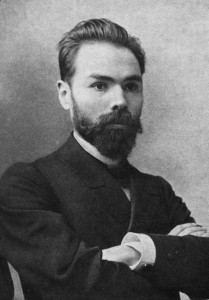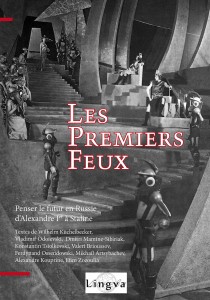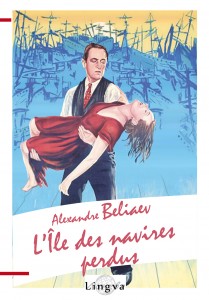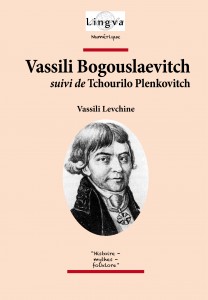Personne encore n’a répondu au premier article d’Eugène Séménoff, mais après sa publication, les discussions sont allées bon train en Russie, et curieusement, ce n’est pas tant sur l’érotisme qu’on l’a critiqué, mais sur la notion d’anarchisme mystique. Aussi Eugène Séménoff se sent-il obligé de préciser sa pensée, avec un nouvel article qui va réellement mettre le feu aux poudres.
Eugène Séménoff
Le mysticisme anarchique
Mercure de France, juillet 1907.
Qu’il me soit permis de débuter aujourd’hui – une fois n’est pas coutume – par un mot personnel. Ma dernière chronique a eu l’heur de susciter l’attention publique dans notre Landerneau littéraire. Pensez donc : j’avais abordé les nouveaux courants dans la littérature russe et, en en présentant un seul, – l’érotisme dans un aperçu forcément sommaire, – j’en avais parlé sans arrière-pensée aucune, mais avec toute l’indépendance et la liberté d’opinion que le Mercure accorde à ses collaborateurs. Plusieurs confrères l’ont compris et ont accueilli mon premier essai avec bienveillance et sympathie ; d’autres ont exprimé des regrets, trouvant mon « étude » (?) trop sommaire ; d’autres enfin m’en veulent de n’avoir cité que trois critiques russes : je leur promets de les citer, eux aussi, à la première occasion, si… elle se présente. Quant au fond de leurs griefs, à savoir que j’ai traité à la légère la littérature russe, je leur conseillerai de commencer par lire ce que je dis dans ma chronique (v. le Mercure du 15 mai) et ne pas se fier à des traductions plus ou moins exactes. Nous causerons après. Là, comme toujours, je cite et laisse parler les faits et les écrits eux-mêmes. Je n’interviens, je ne commente que lorsque cela est nécessaire pour éclairer, pour guider un lecteur étranger. C’est à cette méthode sûre, la seule loyale et productive, que je vais encore avoir recours aujourd’hui.
J’ai eu l’occasion de mentionner parmi les nouveaux courants de la littérature russe, l’anarchisme mystique, et de citer un de ses protagonistes, Georges Tchoulkoff, directeur des Flambeaux (Fakely). Comme nous allons le voir tout de suite, l’anarchisme mystique n’est pas une école, mais un courant de la nouvelle poésie russe, comme l’appellent beaucoup de jeunes qui se parent d’un titre générique ou plutôt général de symbolistes et qu’on peut diviser en trois branches : décadents, romantiques néochrétiens et anarchistes mystiques, lesquels se subdivisent encore. Les décadents sont 1°) les Parnassiens : Valery Brussov, Serge Soloviev, Max Volochine, etc. ; 2°) les décadents purs : K. Balmont, Féodor Sologoub, M. Kouzmine, etc. – Les romantiques néochrétiens ont les meilleurs noms : D. Merejkovsky, Zinaïde Hippius, D. Philosophoff, Berdiaieff, André Biely, etc., qui sont des symbolistes par excellence. – Enfin les anarchistes mystiques sont représentés par le groupe de : Viatcheslav Ivanoff, Alexandre Blok, Serge Gorodetzky, Georguy Tchoulkoff, etc.
Je crois n’avoir oublié aucun des travailleurs plus ou moins en vue du Laboratoire moderne d’où sortent les nouvelles idées littéraires, la nouvelle poésie.
J’ai laissé de côté Gorky, Léonide Andreïeff, le doyen Korolenko, le grand patriarche de Iasnaïa Poliana, ainsi que plusieurs autres noms tels que Kouprine, Boris Zaitzeff, Goussef-Orenbourgsky, J. Bounine, Sérafimovitch et des plus jeunes dont je parlerai encore, etc., et qui ne croient pas aux bonnes écoles, mais aux bonnes œuvres. Cependant, et c’est la caractéristique de notre époque en mal de transformation littéraire, pour des raisons d’affinité ou toute autre cause qui se révélera sûrement, de nouvelles combinaisons sont en train de se produire, et les anarchistes mystiques, par exemple, vont marcher avec l’homme qui à l’heure qu’il est attire le plus l’attention et inspire le plus d’espérances littéraires, avec L. Andréïeff, dont une nouvelle œuvre paraîtra dans la prochaine livraison des Flambeaux.
En caractérisant ainsi les différentes tendances de la littérature russe actuelle, je ne fais que résumer, en les concentrant, les opinions courantes dans le monde littéraire. Pour en avoir le cœur net et afin de donner à nos lecteurs des chroniques documentées, je me propose de faire parler devant eux les écrivains mis en cause, eux-mêmes. Pour commencer, je donne la parole à M. G. Tchoulkoff, directeur des Flambeaux, qu’il alluma après s’être séparé, avec ses amis, du groupe d’écrivains de talent : Merejkovsky, Hippius, etc.
À ma demande de bien vouloir définir, pour les lecteurs du Mercure, l’anarchisme mystique, il le fit, avec la meilleure grâce et avec une parfaite courtoisie, dans ces termes :
« Un de mes critiques, qui m’avait plus d’une fois attaqué très vivement, est tout récemment arrivé à cette conclusion : que ‛toute la jeune littérature russe’ demeure dans le giron de l’anarchisme ‛mystique’. Je pense que cette affirmation est loin d’être vraie, et je m’explique.
L’anarchisme mystique n’est pas un école littéraire qui prétende découvrir de nouvelles méthodes dans l’art.
L’anarchisme mystique est un certain ensemble complexe d’idées philosophiques que j’ai cru nécessaire de mettre à jour en raison de la crise religieuse et philosophique que la société cultivée traverse à l’heure qu’il est en Russie. Je ne suis pas à même, cela va sans dire, d’exposer dans un court entretien toute l’idéologie de l’anarchisme mystique, je dirai seulement qu’il jette une nouvelle lumière sur l’idée de la personne humaine et propose un nouveau schéma de la théorie du progrès. Tout cela n’est pas encore complètement étudié, mais la littérature considérable provoquée par mes brochures et articles dans les Flambeaux me fait penser que ce n’est pas par pur hasard que les mots d’ordre des idées que j’ai énoncées agitent tant de monde : j’ai deviné que l’homme russe contemporain se trouve à un certain tournant psychologique.
Les idées mystico-anarchiques ont surgi sur le terrain de désillusion de la philosophie du positivisme courant et comme une protestation, d’un autre côté, contre le nouveau dogmatisme aveugle auquel sont enclins les restaurateurs de l’orthodoxie et nos néo-chrétiens. Le schéma de l’anarchisme mystique est celui-ci : la personnalité s’affirme par la volonté. Se relevant dans le monde empirique, la personnalité humaine se heurte à l’antinomie de la liberté et de la nécessité. Vaincre la nécessité n’est possible que par l’amour, dont la nature est définie, non pas par la morale, mais par la religion. Demeurant sur le terrain du réalisme mystique, nous nous affirmons non seulement métaphysiquement, mais aussi mystiquement. La personne demeure dans le giron du principe absolu, mais le principe absolu lui-même affirme d’une manière immanente son existence dans la personnalité humaine, car la personne c’est l’absolu en devenir.
La personne aspire à l’unité, mais cette unité n’est pas élémentaire, mais absolue ; par conséquent elle comprend toute la complexité et la plénitude de la vie.
La personne s’affirme non pas dans l’individualisme isolé, mais dans l’individualisme suprême et parfait qui cherche son expression dans la sociabilité. La sociabilité ne conduit la personne à son affirmation que dans le cas où elle est basée sur les principes de l’union anarchique et libre de l’amour. La sociabilité, fondée sur les principes du droit et de la contrainte, n’affirme pas, mais tue la personne. De là notre attitude intransigeante et révolutionnaire envers tout étatisme et envers l’institution de la propriété.
Nous ne posons aucune limite ni ne connaissons aucune autorité. Ainsi le principe moral ne nous pousse pas vers la non-résistance au mal. Notre attitude envers le processus historique est par conséquent toujours active.
À chaque moment de l’histoire, nous nous appuyons sur le groupe qui n’est pas dépravé par la construction politique et qui est révolutionnaire par excellence. Cependant nous ne faisons pas que détruire, mais nous créons aussi. Mais notre création est complètement étrangère au principe mécanique. Notre création est celle de l’amour. Et les seules normes que nous reconnaissons sont celles de l’art, c’est-à-dire les normes musicales.
Mon ami et maître Viatcheslav Ivanov donne une conception un peu différente de l’« anarchisme mystique ». Chez lui, on aperçoit un certain écart vers la passivité et l’indifférentisme par rapport au processus social. Établir la différence de ces deux conceptions de l’anarchisme mystique est l’affaire de la critique académique, laquelle ne va pas tarder, car notre jeune philosophe de grand talent, Alexandre Meier, va incessamment publier son grand travail philosopho-scientifique : Qu’est-ce que l’anarchisme mystique ?
Quant aux rapports entre l’anarchisme mystique et les écoles littéraires, on ne peut tirer de son essence même que la conclusion suivante : la vraie poésie, en tant qu’elle est irrationnelle, s’affirme toujours sous la marque de l’anarchisme mystique. Il est cependant difficile de nier l’influence d’un credo sur telle ou telle école littéraire. Même nos décadents qui ont proclamé le principe de l’indépendance de l’art prirent à proprement parler une position d’idées assez solide. En considérant ce côté rationnel de la poésie, il faudra reconnaître que l’anarchisme mystique donne une base théorique à une école poétique définie. Cette école, dont les principes sont défendus avec succès par le poète de talent Viatcheslav Ivanov, est l’école mytho-créatrice, qui trouve son expression dans les recueils et livres de la publication Orae à Saint-Pétersbourg. L’essence de cette école se caractérise par le besoin non seulement d’incarner les survivances de la personne, mais aussi d’affirmer ces survivances, comme des réalités précieuses en elles-mêmes, comme un mythe. Une telle réalité pour Viatcheslav Ivanov est, par exemple, le mythe de Dionysos.
Quant aux recueils des Flambeaux, que j’ai l’honneur de diriger, ils ne défendent les idées mystico-anarchiques que dans les articles théoriques et excluent tout programme de la rubrique poésie. Ici, à côté des œuvres de Viatcheslav Ivanov, je publie avec joie celle de Léonide Andreïeff, Feodor Sologoub, Alexandre Blok, L. Zinoviev-Hannibal, S. Gorodetzky et quelques autres… »
Ainsi parla M. Tchoulkoff qui fait en même temps la critique théâtrale dans le grand quotidien le Tovarichtch.
Je passe sur l’amitié que les uns professent pour M. Tchoulkoff, sur la critique des autres qui le démolit. Habemus confitentem reum : en fait de document je ne puis donner une confession littéraire d’un jeune plus complète que celle que je viens de donner. L’époque que la Russie traverse est trop intéressante sous tous les rapports pour en négliger un élément quelconque. Je les présenterai tous – au point de vue littéraire et artistique – au fur et à mesure, en toute conscience et toute liberté, restant moi-même fidèle aux vieilles et bonnes traditions de la littérature russe qui va de Pouchkine à Korolenko et à Gorky, oui, à Gorky, que d’aucuns enterrent déjà, et de Belinsky à Mikhaïlovsky et me rappelant toujours le mot de mon éminent maître et ami G. Brandes :
« Il n’y a pas de bonne ou mauvaise école, il n’y a que de bonnes ou mauvaises œuvres. »
Les premières restent, les autres… passent.