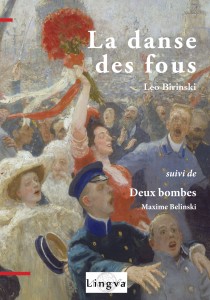La Danse des fous de Leo Birinski a été jouée un peu partout en Europe, avant la Première Guerre mondiale, et ce y compris en France. Elle fut créée en 1912, mais elle n’arriva chez nous qu’en 1914. Cela aurait pu mal se faire, car en 1912, un critique anonyme, sur la fois de témoignages de seconde main, écrivait dans Le Monde artiste :
« Munich. – La Danse des fous, de M. Birinski, a obtenu un succès d’estime. On avait fait beaucoup de bruit autour de cette œuvre qui, finalement, a paru lourde, longue et monotone. »
Le Monde artiste, 12 octobre 1912.
Pourtant, la pièce fut adaptée par Maurice Rémon, et jouée par la troupe du théâtre de l’Œuvre, d’abord dans ses propres locaux, puis au théâtre Antoine. Et ce fut un succès, tant populaire que critique. La plupart des grands journaux, tant quotidiens qu’hebdomadaires, de gauche comme de droite, voire d’extrême droite, en ont vanté les qualités.
La pièce, visiblement, aurait pu devenir un classique. Mais il y eu la guerre, puis l’émigration de Leo Birinski aux USA : l’auteur, devenant scénariste et producteur de cinéma, abandonna alors son œuvre théâtrale. Et pourtant ce succès avait tout pour le satisfaire. Il se fendit d’ailleurs d’une lettre, publiée dans le Journal des débats politiques et littéraires (6 avril 1914), adressé au directeur de la troupe :
« Mon cher directeur et ami,
Voilà ce qui peut arriver de plus agréable et de plus flatteur à un dramaturge : dans la même semaine être à l’Œuvre, puis au théâtre Antoine, où se groupent les souvenirs les plus glorieux des lettres françaises et justement sous la direction du grand artiste Gémier.
L’accueil de la répétition générale, si sympathique à un écrivain étranger, me touche infiniment, et je voulais, avant la reprise de lundi, en dire ma reconnaissance à la critique et au public parisien.
Votre,
Léo Birinski »
Nous avons recherché ces critiques anciennes de la Danse des fous. Elles sont nombreuses. En voici une sélection, classée par ordre de publication. Et si elles dévoilent beaucoup du contenu de la pièce, elles n’empêche en rien sa lecture, tant Leo Birinski a le sens de la formule, de la phrase drôle.
Edmond Sée, Gil Blas, 1er avril 1914
À l’Œuvre, nous avons écouté une pièce âpre et curieuse, de M. Léo Birinski : « La Danse des fous », et deux actes philosophiques de M. Pierre Bienaimé : « Les Pygmées ».
L’auteur de la première comédie est un jeune écrivain russe, dont l’esprit satirique s’est éveillé, je pense, durant les chaudes journées de 1905. Ainsi M. Birinski a fait, d’après nature, plusieurs observations touchant la misère intellectuelle des paysans, la folie novatrice des étudiants, et la vénalité des fonctionnaires, en Russie. Ces observations forment le fond âpre et joyeux de sa pièce : La Danse des fous. Et les fous, ce sont les acteurs de cette grande révolution qui avorta, en grande partie, à cause des rôles mal appris, mal compris ou mal distribués.
Les trois actes de la Danse des fous forment, en réalité, trois tableaux, dont le premier se relie directement au dernier. Quant au second — le meilleur — ce n’est qu’une manière d’intermède destiné à nous montrer « les fous » en pleine effervescence.
Donc, voici, au premier acte, certain gouverneur, que sa femme trahit avec un apprenti révolutionnaire, nommé Kosakow. Le gouverneur supporte fort bien les menées amoureuses de sa compagne (qui est sa seconde femme), car il est pour la paix à tout prix ! Pour la paix ; et aussi pour les gras émoluments que lui vaut sa charge, et qu’il voudrait grossir encore, le bon gouverneur ! Mais, dans ce trou de pays, il ne se passe rien. Ah ! si l’on pouvait « mettre la main » sur quelque chose : une bonne petite révolution, ou seulement un attentat ! Voilà qui justifierait toutes les demandes de crédits supplémentaires. De plus, on serait bien vu en Haut lieu !
Le gouverneur, d’accord avec son secrétaire, imagine peu à peu d’organiser une comédie pour arriver à ses fins. Voici : le secrétaire tirera un coup de pistolet (en l’air), et son maître fera semblant de s’affaisser. Attentat terroriste ! Et, après, on avisera. Aussitôt dit, aussitôt fait. Le coup de feu part. Le gouverneur tombe. Et ses amis, ses serviteurs l’entourent, affolés.
Cependant, en voici bien d’une autre. Au dernier acte, Kosakow, l’ami de la femme du gouverneur, se dénonce comme étant le coupable ! S’il a tiré, c’est qu’il aimait sa maîtresse, et haïssait le mari. Crime passionnel, par conséquent ; et, ainsi, l’héroïque jeune homme sauvera ses compagnons.
Vous devinez l’ahurissement du gouverneur devant ce pseudo-coupable, qui ne rêve que d’être arrêté, tandis que l’autre ne cherche qu’à étouffer l’affaire. Les deux compères nous donnent un réjouissant spectacle, jusqu’au moment où une dépêche du gouvernement annonce au gouverneur qu’on récompense largement ses services.
J’ai volontairement omis de parler du second acte, me réservant de le conter à part. Ce second acte n’est, en effet, qu’un tableau de mœurs. Et il se compose de scènes presque toutes accessoires, et qui n’ajoutent pas grand-chose à l’épisode principal : du gouverneur codifié et conspirant contre lui-même. Elles n’en sont pas moins, ces scènes, très significatives et d’une puissante et, parfois, très atroce ironie.
Décor : une salle d’école. Dans cette salle, les étudiants conspirateurs. Peu à peu ils s’exaltent, se grisent pour l’idée révolutionnaire, chacun servant sa chimère, et, en croyant parler pour tous, ne songeant en réalité qu’à soi-même. Ainsi l’étudiant juif plaide la cause de ses coreligionnaires ; la féministe, celle du féminisme, etc. En réalité, ces pauvres jeunes gens sont animés des meilleures intentions, mais leur cerveau, un peu jeune et un peu fumeux, les entraîne ici et là, sans frein ni règle ; et ils ne savent au juste ni ce qu’ils souhaitent réellement, ni où ils vont, Le moindre mot, le moindre refrain les enflamme et les égare. Si bien que lorsque, soudain, un vieux paysan presque gâteux est amené devant cet aréopage (à la suite de circonstances fortuites) et ne peut que balbutier : « Ne me faites pas du tort ! Qu’on ne me fasse pas du tort ! », ces pauvres et naïfs artisans d’une révolution improbable et avortée d’avance l’entourent, le réconfortent, lui jurent qu’on le protégera, et, à propos de lui (qui n’est plus là, qui a pris la porte), agitent les plus graves problèmes sociaux, les plus grands problèmes humanitaires.
Cet acte est d’une ironie très originale, très puissante, qui va loin. L’homme capable de le concevoir et de l’écrire mérite notre estime la meilleure. Il ne faut pas la lui marchander. Et à cause de cette simple scène, « du Paysan et des Étudiants », nous devons lui pardonner ce que le début de la pièce et le dénouement offrent d’un peu concerté, de trop appuyé, sans doute, et d’outrancièrement vaudevillesque.
La Danse des fous, mise en scène avec intelligence et habileté, a été excellemment interprétée dans l’ensemble par MM. Froment, Savoy, Blancard, Bernard, Lugné-Poë (c’est lui le vieux paysan, et vous voyez d’ici ce que l’artiste a fait d’un tel personnage !), Lacressonnière ; Mmes Vernoux et Kessel, remarquables comédiennes, si vivantes, si bien ajustées.
Adolphe Aderer, Le Petit Parisien, 2 avril 1914
L’Œuvre a donné hier, au théâtre Antoine, la Danse des fous, pièce habilement adaptée du russe, de M. Birinski par M. Maurice Rémon et qui, sous sa fantaisie un peu osée et malgré son parti pris satirique, n’en est pas moins une étude très documentée de mœurs administratives et révolutionnaires russes.
Un gouverneur de province, pour obtenir du ministère des fonds supplémentaires sous prétexte de combattre le nihilisme, a envoyé des rapports où il raconte de prétendues menées de conspirateurs : il a peur qu’on ne finisse par apprendre la vérité à Saint-Pétersbourg, à savoir que son gouvernement est le plus tranquille de toute la Russie, et d’accord avec son secrétaire, il fait tirer sur sa personne deux inoffensives balles de revolver. Or, son district est précisément le refuge d’un grand nombre de révolutionnaires qui s’y cachent sous des noms supposés. Ils ont intérêt à y maintenir le plus grand calme pour ne pas attirer l’attention de la police sur cette terre d’asile, aussi sont-ils consternés à la nouvelle d’un attentat qu’ils prennent pour un acte d’indiscipline imbécile commis par un compagnon.
Afin d’en pallier l’effet, l’un d’eux, familier de la maison du gouverneur, et que la femme de celui-ci poursuit de son amour romanesque et suranné, se dénonce comme auteur de la tentative criminelle à laquelle il aurait été entraîné, dit-il, par une passion irrésistible pour son épouse. On devine la stupéfaction et la déconvenue du gouverneur.
Cette pièce étrange a été jouée avec une gesticulation de fantoches, que comportaient, semble-t-il, les intentions de l’auteur, par M. Jean Froment, un gouverneur falot et débonnaire, Mme du Rieux (la femme du gouverneur), fort divertissante, et M. Lugné-Poé, symbolique et excitant la pitié, en paysan russe.
Charles Martel, L’Aurore, 3 avril 1914
La Danse des fous que M. Lugné-Poë a montrée de très pittoresque façon, soignant à l’exquis ses types de nihilistes, est une très pessimiste et ironique pièce qui tourne au bouffon, à la manière de tant de drames. C’est une histoire de révolutionnaires et de policiers, les uns et les autres très vrais d’ailleurs et tout à fait dignes d’être du « Grand Soir », mais présentés de façon à dégager la drôlerie contenue en tout acte et en tout être si bien que Montaigne a pu dire : « Toutes nos vocations farcesques ».
Pour mieux préparer l’avenir les révolutionnaires d’une certaine province russe ont voulu que le présent n’inspirât aucune inquiétude au bon ordre et à ce qu’il n’arrive rien de fâcheux au général gouverneur. C’est un point que ce dernier, exaspéré d’être inutile en vient à simuler un attentat. Son secrétaire décharge deux fois un revolver et raconte que les balles ont été tirées du dehors. Navrement des révolutionnaires. Il faut parer le coup. À une réunion – et le tableau est une critique charmante et discrète des types et des idées nihilistes – il est décidé que l’on fera croire à un attentat non plus politique mais passionnel. Justement Kosakow, par dévouement à la cause a cédé aux terribles instances de la femme du gouverneur, il prétendra avoir tiré sur le mari pour posséder l’aimée à lui tout seul. Et la scène est vraiment excellente où il vient se livrer au gouverneur comme auteur de l’attentat que le gouverneur sait n’avoir pas été commis. Pour le décider à se rétracter les offres les plus brillantes lui sont faites, y compris celle de la générale, mais un faux aveu en entraîne de véritables et le général apprend et qu’il y a réellement des révolutionnaires dans la province et que pour s’assurer contre toute trahison, ils ont déposé leur caisse au palais même du gouverneur. Maintenant le gouverneur feint d’être de mèche avec eux, se trouve armé pour mériter toutes croix et tout avancement.
Ces gens sont fous (c’est la danse des fous), et ainsi est-il permis de dire qu’ils sont vrais. On a beaucoup ri et M. Lugné-Poë, admirable en un vieux paysan abruti que les nihilistes prennent comme pure expression de la conscience populaire, MM. Froment, Savoy, Blancard, Cerny, Mmes Vernoux, Gaby Kessel, du Rieux, Richard Turner, ont donné en artistes tout son mouvement à la danse.
Robert de Flers, Le Figaro, 5 avril 1914.
Lugné-Poe – et nous ne saurions trop l’en louer – poursuit avec un zèle et une initiative qui ne se ralentissent point la série des représentations de « l’Œuvre ». Celle qu’il vient de nous offrir nous a permis de connaître un ouvrage extrêmement curieux, d’un ton cinglant et original – et qui nous présente la littérature russe sous un aspect violemment comique qui, il faut bien l’avouer, n’est pas toujours le sien. Cette pièce a pour auteur M. Léo Birinski, et s’appelle La Danse des fous.
C’est une farce satirique sur la révolution russe de 1905. Nous avons, en France, un respect touchant pour les révolutionnaires slaves ; nous aimons qu’ils nous émeuvent ou qu’ils nous fassent trembler. Cette fois, ils nous ont fait rire ; ils sont devenus, ainsi que leurs ennemis et leurs persécuteurs, des personnages comiques. Grâces en soient rendues à l’humour de M. Birinski. Cet humour, qui fait songer parfois à Bernard Shaw, est singulièrement âpre et puissant tout en restant dans le ton de la bouffonnerie. L’ironie de l’auteur n’épargne ni les intellectuels, ni les fonctionnaires, ni le peuple, et son œuvre ressemble à un vaudeville politique et social, qui serait inspiré par un nihilisme dilettante et un mépris sans bornes de l’humanité. L’idée de la pièce est ingénieuse et plaisante ; les effets sont parfois un peu gros : il y a excès dans la charge ; peut-être, à l’étranger, où La Danse des fous a rencontré un grand succès, goute-t-on mieux qu’en France ce comique violent et un peu lourd, mais nous préférons plus de légèreté dans la satire.
Le gouverneur d’une province russe, vénal comme ils le sont tous depuis Gogol, veut faire croire à Saint-Pétersbourg que sa province est en proie à la révolution ; ainsi on lui enverra, pour lutter contre elle des subsides qu’il mettra dans sa poche. Il simule un attentat contre sa personne, en faisant tirer en l’air deux coups de revolver par son secrétaire. Les révolutionnaires de la ville, étudiants pour la plupart, sont désespérés de l’incident, car ils ne désirent qu’une chose : le maintien de l’ordre. Utopistes et bavards, ils se disputent entre eux, mais ils veulent que la police les laisse tranquilles. Alors, l’un d’eux, Kosakoff, ira se dénoncer au gouverneur comme l’auteur de l’attentat, afin que ses camarades ne soient pas inquiétés ; il déclarera qu’il aime la femme du gouverneur, et qu’il a tiré sur lui par jalousie. La scène entre Kosakoff et sa prétendue victime est d’une bouffonnerie charmante ; le gouverneur se refuse à envoyer l’étudiant en prison, et il veut à tout prix lui céder sa femme pour s’en débarrasser. Il a réussi, malgré les révolutionnaires, à organiser un semblant de révolution. Aussi reçoit-il un avancement mérité.
Jean Froment a eu de la verve et de l’adresse dans le rôle du gouverneur ; M. Lugné-Poe a été fort amusant dans celui du vieux paysan stupide qui répète toujours la même phrase ; MM. Savoy, Blancard, Armand Bernard, Mmes Vernoux, Gaby Kessel, Du Rieux, méritent d’être nommés.
Léonce Beaujeu, L’Action française, 5 avril 1914.
Curieux spectacle au Théâtre de l’Œuvre. Nous sommes un peu blasés sur les grands auteurs moscovites, les génies slaves. Le Birinski que M. Lugué-Poë nous a révélé par l’adaptation de M. Maurice Rémon mérite pourtant qu’on l’écoute.
Auriez-vous cru qu’un pût faire (et autrement que dans Tartarin sur les Alpes) de la bouffonnerie avec la révolution russe et le nihilisme ? C’est ce que Birinski a fait dans la Danse des fous. Je vais d’ailleurs vous dire le secret de Birinski, et il est bien simple : Birinski méprise toute l’humanité, les brigands comme les gendarmes, et toutes les idéologies, celle de l’ordre comme celle du désordre. Il se rit même de l’amour. Il se plaît à étaler la niaiserie de la jeunesse : c’est ce qu’on peut voir de plus fort en fait de scepticisme, de plus complet en fait de pessimisme… Le gouverneur de la province est désolé que sa province soit la plus tranquille de toute la Russie parce que, de la révolution à réprimer, cela rapporte de l’avancement et aussi des fonds dans lesquels le tripotage est facile. D’autre part, les révolutionnaires dont ladite province est l’asile, ne veulent pas y troubler l’ordre. Le gouverneur en vient à simuler un attentat contre sa propre vie. Un des nihilistes s’en accuse, mais transforme le prétendu crime politique en drame passionnel, sous prétexte qu’il aime la femme du gouverneur. En réalité ce nihiliste est un grand héros, car la femme du gouverneur est une terrible harpie. – « Prenez-la donc, dit au nihiliste le cynique fonctionnaire. » Il y a là, entre les deux hommes, une scène d’un comique bien appuyé, bien prolongé, un comique un peu cosaque, parfois avec d’assez bons traits. Remarquable aussi, pour sa verdeur, l’acte où l’on voit le club nihiliste en délire idéologique. M. Lugué-Poë a dessiné une étonnante figure de paysan russe qui représente le « peuple » aux yeux des jeunes anarchistes d’Université. Tout cela a une forte saveur de slavisme. C’est de l’ironie d’ours blanc.
Adolphe Brisson, Le Temps, 6 avril 1914
Un effroyable déluge d’œuvres nouvelles nous a, cette semaine, submergés. Il nous est on ne peut plus douloureux de les passer sous silence, ou de ne leur consacrer que des lignes hâtives. Quelques-unes auraient droit à un meilleur traitement. M. Lugné-Poé, toujours attentif à suivre les manifestations des littératures étrangères, a révélé aux Parisiens les beautés singulières, savoureuses, de la Danse des fous, de M. Léo Birinski, satire âpre, sinistre et comique des milieux révolutionnaires et des mœurs administratives de la Russie. L’auteur flagelle tout ensemble le cabotinage du faux nihilisme, la corruption du fonctionnarisme, maux qui ne se neutralisent pas, mais s’additionnent pour la plus grande misère des braves gens. Je souhaite vivement que de nouvelles représentations de cette comédie soient offertes au public. Ce me sera une occasion d’en reparler.
Gabriel Reuillard, Les Hommes du jour, 11 avril 1914.
Lugné Poe connut, avec ses spectacles du Théâtre de L’Œuvre qu’il dirige, des fortunes diverses. Cette fois, en montrant avec soin et avec ingéniosité, La Danse des Fous, trois actes de M. Léo Birinski, adaptés par M. Maurice Rémon, il a donné un spectacle attrayant, original, heureux. À dire vrai, cette pièce bouffonne quelquefois, impertinente et vive, est d’une amertume très caractérisée. Et pour être caustique, son pessimisme n’en est pas moins désabusé. Cette danse des fous, ce n’est, au fond, que l’avortement de nos rêves d’émancipation humaine. Et si la ronde en est, parfois, échevelée, les mobiles qui la dirigent et la font se mouvoir ne sont, hélas ! que de pauvres petits mobiles sans chaleur. Cette pièce est assez difficile à classer pour le critique. Elle tient à la fois de la satire et de la comédie – et quelquefois aussi du vaudeville. Elle est cependant bien écrite, c’est-à-dire que ce que nous en connaissons par l’adaptation est clair, sûr et hardi. Il faut féliciter M. Lugné Poe d’avoir fait connaître cette Œuvre intéressante.
Henri Bidou, Journal des débats politiques et littéraires, 13 avril 1914
Léo Birinski est un jeune auteur russe fixé à Vienne et qui a donné deux pièces sur la révolution de 1905. La première se nomme Moloch. C’est une tragédie, dont quelques scènes sont parmi les plus poignantes qui se puissent voir. Tout le début est le tableau d’un groupe ardent de révolutionnaires, dans une ville russe. Leur chef Sacha est prisonnier ; ils le délivreront. Ils font avec une simplicité héroïque le sacrifice de leur vie. Et quelle hécatombe ! Il y a un an ils étaient soixante-huit, ils sont maintenant une vingtaine. Quatre se font encore tuer en délivrant Sacha, qui est tiré de prison dans la bière d’un mort. Pourquoi tiennent-ils à ce point à le délivrer ? C’est qu’il ressemble étrangement au lieutenant du gouverneur. Il pourra à la faveur de cette ressemblance pénétrer dans le palais, et tuer le gouverneur… On sacrifie quatre existences pour le rendre libre et pour l’envoyer tuer. Seulement dans la prison Sacha a réfléchi. Il hait ce monstre dévorateur de tant de vies, cette Humanité, abstraction, vue de l’esprit, pour qui il va mourir. La révolution ne lui paraît plus qu’un jeu de fous, et il refuse maintenant d’assassiner. Mais est-on libre de choisir ses actions ? Il se sent emporté par le courant qu’il a lui-même créé. Il faut donc qu’il tue, et il demande à périr en même temps qu’il frappera. Mais le destin ne lui laisse pas le temps d’agir. Une servante, en croyant le protéger, le dénonce. Les cosaques arrivent et l’abattent. Au moment de mourir, il prie l’officier de s’approcher et il lui fait en expirant cette recommandation ironique : « Saluez pour moi l’Humanité. »
La pièce que M. Lugné-Poe avait jouée à l’Œuvre et que M. Gémier vient de reprendre est une comédie. On y trouverait sans peine le même fond d’amertume, et tout le second acte est une peinture à la fois attendrie et ironique des révolutionnaires, de leurs discussions éternelles, de leurs méprises, de leur candeur, de leur héroïsme intempérant et obstiné. En face d’eux l’auteur a représenté le fonctionnaire tel déjà qu’il était peint au temps de Gogol, et Ivan Chabarovitch, cupide, vénal et faible, ressemble aux personnages du Reviseur. Seulement l’auteur a inventé une situation qui est la pièce même et qui est fort plaisante. Les terroristes ne veulent pas de révolution dans cette ville, où ils se réfugient et où ils cachent leurs archives, et au contraire des troubles sont absolument nécessaires au gouverneur, qui a déjà mangé l’argent nécessaire à les réprimer. De sorte que Chabarovitch organise un attentat contre lui-même, au grand effroi des révolutionnaires… La comédie est d’une verve fort plaisante, mêlée par endroits de passages émouvants ; et la satire, tantôt caustique, tantôt presque attendrie, se traduit par des traits de caractère, des incidents, des oppositions et des surprises qui sont de l’excellent théâtre.
Edmond Stoullig, Les Annales du théâtre et de la musique, 1914-1915, 1916.
Le 1er avril 1914, l’Œuvre nous avait donné, sur la scène du Théâtre Antoine, accompagnés des Pygmées, deux actes, de M. Pierre Bienaimé, la Danse des Fous, comédie en trois actes de Léo Birinski, adaptation de M. Maurice Rémon. Traduite en toutes les langues, même en japonais, jouée le même soir dans quinze villes différentes la comédie satirique de M. Birinski, la Danse des Fous, excita partout une vive curiosité. Curiosité justifiée par l’ironie gaie, le scepticisme exhilarant qui se dégagent d’une observation de mœurs, souvent poussée à la charge. Il semble que l’auteur, après tant de tragédies révolutionnaires, de tentatives libertaires noyées dans le sang des anarchistes russes, se soit décidé à ne pas prendre tout cela au sérieux. La Danse des Fous, c’est-à-dire l’agitation inutile de pantins politiques et sociaux – et aussi la danse des idées généreuses jetées au hasard comme le grain qu’on sème, et qui vole, et qui tombe, et qui germe au hasard du vent qui souffle.
Et aussi la danse de l’ambition, de la corruption des fonctionnaires, qui finit par entraîner, dans son tourbillon destructeur, les poètes qu’agite l’idéal social, victimes naïves de leur élan de charité. Cependant – et c’est pour être autorisé à toutes les audaces – l’auteur a pris pour point de départ une donnée d’opérette. Un gouverneur de province de la Russie méridionale, vieux, grotesque, ambitieux, craint de n’être plus en faveur en haut lieu, car il n’a à réprimer aucun complot anarchiste. Si la province reste à ce point tranquille, quel prétexte aura-t-il pour demander que la police de Pétersbourg lui envoie des fonds destinés à la répression ? Sans compter que le bruit peut se répandre qu’il lance de fausses nouvelles d’agitation politique : il risque alors la Sibérie. Pour sauver sa situation, il organise donc un faux complot. Son secrétaire tirera par la fenêtre quelques coups de revolver ; on criera : « Au meurtre ! » Le gouverneur simulera des blessures et le tour sera joué. Or, cette province est le refuge d’une bande d’étudiants révolutionnaires ; se trouvant là en sûreté précisément par le défaut d’attentats ils se sont opposés à toute manifestation brutale qui donnerait l’éveil sur leur présence réelle en faisant naître des perquisitions. Le second acte nous montre précisément une réunion de ces étudiants.
Birinski y a habilement et comiquement exposé l’incohérence et la candeur d’esprits enthousiastes, qui, hypnotisés par le bonheur de l’humanité, incapables de réaliser leur rêve, cherchent à le formuler en des mots vides et sonores dont chacun comprend le sens différemment. Les diverses questions sociales y sont effleurées : l’antimilitarisme, les lois agraires, le féminisme, la diffusion des écoles, le problème juif. Tout le monde parle en même temps – personne n’écoute. Et au sein de ces tentatives d’envolée plane le symbole du peuple en la personne d’un vieux moujik tremblant et pitoyable qu’on cherche à faire entrer dans les discussions de haute portée sociale, à qui on demande son avis, et qui, ignorant, asservi, dominé par la crainte, ne sait que répondre : « Permettez, petit père, qu’on ne me fasse pas de tort ! » Jusqu’au moment où, symbole du peuple, victime de sa faiblesse même et de sa résignation, c’est lui que le maître emprisonne à coups de pied dans le derrière. Brusquement un des étudiants vient annoncer une grave nouvelle. Un attentat (le faux attentat) a été commis. Ainsi la sécurité de tous se trouve compromise.
Que faire ? Pour empêcher les perquisitions et les recherches de complices, il faut que l’un d’eux, au hasard, se dénonce. Il avouera avoir tiré, non par haine politique, mais pour une raison intime : la jalousie passionnelle par exemple. Et c’est pourquoi celui qu’on envoie se dénoncer, c’est-à-dire à la mort, sera l’amant de la femme du gouverneur.
Alors les têtes se découvrent, et en l’honneur de la victime expiatoire, tous, respectueusement, douloureusement, entonnent l’hymne des esclaves. Cet acte, vraiment curieux, d’une psychologie pittoresque, finit presque en beauté. Le troisième acte est de pur vaudeville. L’étudiant qui se dévoue est accueilli comme l’ami de la maison ; mais, dès que le gouverneur comprend qu’on est venu lui parler de l’attentat, il croit qu’on a deviné son subterfuge et ne veut rien savoir. – « Le meurtrier, c’est moi ! » crie obstinément l’étudiant, le visage illuminé par son sacrifice. « Il est devenu fou ! » conclut le gouverneur qui flatte sa manie, et l’adjure pourtant de consentir à ne pas se faire mettre en prison. Il va même, sachant qu’il est trompé, jusqu’à lui donner sa femme. Enfin, il apprend la vérité : la caisse de la conspiration nihiliste est cachée dans son propre palais. Il laisse croire alors aux révolutionnaires qu’il fait avec eux cause commune pour pouvoir voler l’argent. On voit ce qu’une telle donnée ainsi traitée comporte d’ironie sanglante et d’amère satire. La conquête des réformes sociales s’obtient plus souvent au théâtre par le rire que par la violence. L’auteur l’a bien compris et a écrit une étude savoureuse de mœurs russes qui, par notre public français, a été très goûtée et fort applaudie. Il fallait louer, pour sa mise en scène vivante, M. Lugné-Poë, qui avait campé avec puissance la silhouette falote et douloureuse du moujik qui voudrait qu’on ne lui fasse pas de tort. – Et tel était l’effet de la Danse des Fous, donnée par l’Œuvre, que M. Gémier s’emparait immédiatement de l’intéressante pièce de M. Birinski pour l’annexer à son théâtre, où elle faisait affiche avec la joyeuse Tontine.